 Prof en Segpa, Rachid Zerrouki déjoue les codes">
Prof en Segpa, Rachid Zerrouki déjoue les codes">
Oct / 23
Auteur des Incasables, Rachid Zerrouki est professeur en charge d’une classe Segpa dans un collège de Marseille. Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo « Rachid l’instit », il n’hésite pas à prendre position et à monter au créneau pour davantage d’égalité dès l’école. Entretien avec un prof bien décidé à résoudre quelques dilemmes pédagogiques.
Prof en Segpa, Rachid Zerrouki déjoue les codes
Comment vivez-vous notre époque ?
En tant que citoyen, c’est un peu angoissant. En tant que prof, je vois les débats autour de l’éducation s’empêtrer dans des considérations déconnectées de la réalité. Mais j’aime toujours profondément mon métier. Au sein de mon établissement, je tiens à rester prof sans sortir du cadre car j’aime travailler en équipe et ce que je peux faire à côté reste à côté. Cela me permet de ne pas être pessimiste. Car, quand je suis en classe, avec mes élèves, ça se passe bien. Cela me permet de rester optimiste vis-à-vis de l’avenir.
Pour garder le moral, ou pas, vous avez pris l’habitude de réagir sur les réseaux sociaux, à l’instar de Twitter où vous comptez plus de 60 000 abonnés. Des réseaux où vous avez récemment révélé que des élèves vous ont demandé s’ils allaient devoir changer de prénom suite aux propos d’Eric Zemmour…
Oui, en effet, j’ai été questionné une première fois par mes élèves au sujet des propos d’Eric Zemmour. Je me suis contenté de leur dire qu’il fallait ignorer. Je leur ai expliqué que certaines personnes gagnent parfois de la popularité en se faisant détester. Puis cette tendance sur la francisation des noms est devenue un sujet d’actualité et de société. C’est là que j’ai été questionné une seconde fois. J’ai alors senti qu’il fallait que je prenne position. Ils m’ont demandé si j’étais d’accord avec ça. On pourrait penser que, vis-à-vis de notre devoir de neutralité en tant que prof, on ne doit pas réagir aux propos d’un futur candidat à la présidentielle. Mais avec du recul, je ne regrette pas. Il s’agit aussi d’un devoir de responsabilité que de transmettre les valeurs de la République. Il faut choisir selon ses convictions propres et ce que l’on pense être juste. Je leur ai dit qu’il n’y avait pas de prénom plus français qu’un autre. J’ai trouvé qu’il s’agissait d’une remise en question de leur citoyenneté. Ce n’est pas sur leurs prénoms que l’on doit juger les gens mais sur leurs actes et leurs convictions. Derrière leur indignation, il y avait beaucoup d’étonnement. Pour ma part, je ne suis pas étonné et j’ai la capacité en tant qu’adulte de ne pas généraliser ces propos à l’ensemble de nos dirigeants.
Comment êtes-vous devenu professeur en Section d’enseignement général et professionnel adapté ?
Ce n’était pas une vocation. A la suite de mon concours, je voulais à tout prix éviter les postes de contractuel à mi-temps, fractionnés par-ci par-là. C’est le lot de nombreux enseignants en début de carrière. Je cherchais un poste à temps plein et il y avait un poste en Segpa dont personne ne voulait. J’ai donc tenté le coup, sans vraiment savoir ce qui m’attendait car dans le cadre de ma formation, je n’ai pas le souvenir d’avoir été formé un seul instant pour ce type de classe. Les premiers mois ont été difficiles puis quand il a fallu au bout d’un an se décider pour une mutation ailleurs, j’ai refusé. En Segpa, j’ai trouvé du sens et du plaisir dans ce que je faisais, et j’ai donc décidé de conserver mon poste. Un attachement assez naturel avec les élèves s’est créé. J’ai peu à peu pris du plaisir dans mon enseignement. J’en suis aujourd’hui à ma 7e rentrée. Après une première expérience au Collège des Caillols à Marseille, j’ai changé d’établissement en 2019 où je retrouve une aventure très semblable à la première.
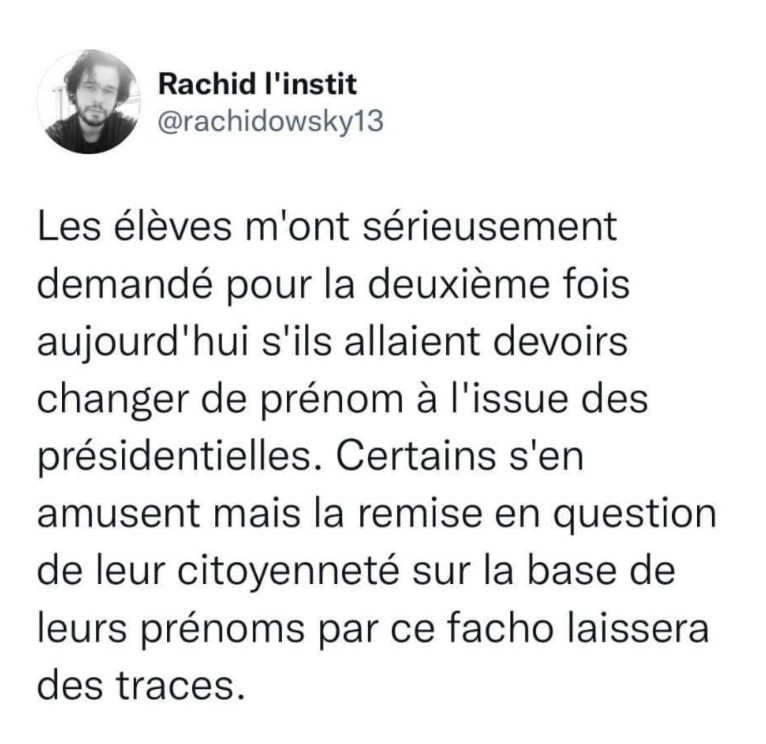 Cette aventure, vous la racontez dans Les Incasables, votre premier ouvrage. Dans ces pages, vous n’hésitez pas à remettre en cause votre formation tout en partageant tout ce que vos élèves vous apportent en tant qu’enseignant. On y ressent beaucoup d’humanité et votre volonté de déjouer les codes…
Cette aventure, vous la racontez dans Les Incasables, votre premier ouvrage. Dans ces pages, vous n’hésitez pas à remettre en cause votre formation tout en partageant tout ce que vos élèves vous apportent en tant qu’enseignant. On y ressent beaucoup d’humanité et votre volonté de déjouer les codes…
Si on remonte à une dizaine d’années, je considère que nous avons fait pas mal de chemin. L’histoire de ces élèves à besoins éducatifs particuliers a commencé avec le doute même sur leur éducabilité. Puis on s’est mis à déplacer plein de catégories en les considérant incasables, cancres, idiots, des termes institutionnels que l’on retrouve dans les archives. Depuis, on progresse mais cela reste timide. On ne veut pas catégoriser mais on parle d’élèves à besoins éducatifs particuliers. On se retrouve finalement dans cette république universaliste qui dit ne pas voir les différences tout en considérant une approche différente pour certains élèves. Sur la prise en compte de toutes et tous, il y a encore du chemin. Surtout lorsqu’on recherche l’origine des difficultés.
Ces difficultés ne sont-elles pas directement liées à la formation des professeurs et au système incarné par l’école française ?
Le manque de formation est évident. Dans mes souvenirs, la formation était basée sur l’élève idéal à faire travailler en autonomie, et le fait d’incarner finalement en tant que professeur un animateur ou un guide. Ce sont des nouvelles idées qui portent leurs fruits mais avec un certain type de public. Même dans nos séquences vidéo, je ne voyais pas d’élèves en difficulté. Une formation centrée davantage sur tous les publics serait bénéfique. On a besoin également de moyens humains et pas uniquement des professeurs. En Segpa, on essaie d’adapter les enseignements en fonction des profils mais notre but premier est d’individualiser les parcours, notamment sur le parcours professionnel. Contrairement à une classe de 35 élèves en voie générale, nous avons un effectif réduit de 16 élèves. Pendant la crise sanitaire, on a accueilli des plus petits groupes. La différence était flagrante pour bien travailler, pour vraiment avoir le temps de connaître chaque élève. Ces élèves n’ont pas besoin de me voir uniquement moi, mais aussi une assistante sociale, un psychologue, des professionnels qui manquent cruellement au sein des établissements. Pour une psychologue scolaire, il faut prendre un rendez-vous deux mois à l’avance car elles travaillent bien souvent sur cinq ou six établissements en même temps.
Est-ce lié au manque de candidats ?
C’est lié à la fois au manque de volonté d’embaucher et au manque de candidats. On parle d’un métier de plus en plus dévalorisé. Il n’y a qu’à voir la courbe du pouvoir d’achat des enseignants en baisse constante. C’est un phénomène qui ne dépend pas que d’un quinquennat. Cela fait longtemps que ça dure. Tout le monde est d’accord pour affirmer l’importance de l’école au sein de la société mais ce n’est pas traité politiquement. Ce n’est pas vu comme stratégique ou en tout cas on ne fait pas en sorte pour que ce le soit. Dans les sondages, les critères de vote à la prochaine présidentielle sont la sécurité et l’immigration, et non l’éducation.

Pourquoi selon vous les élèves scolarisés en SEGPA subissent autant de discriminations et de stigmatisations, au point que le terme sert parfois d’insulte ?
Le terme, c’est vrai, est devenu très stigmatisant. Au fil des ans, ça a pris une certaine ampleur. C’est devenu un mot à part entière, utilisé même en dehors de l’école, pour désigner quelqu’un que l’on juge idiot. Je pense que tout cela est lié au rôle que l’on donne à l’école au sein de notre société. On a cette façon de voir l’école comme une institution qui trie les élèves, qui désigne des élèves qui ne sont pas dignes d’intérêt, qui ne méritent pas le respect, comme des élèves en trop qui seraient inutiles. Or, le rôle de l’école, ce n’est absolument pas cela. Le rôle de l’école, c’est de faire progresser chaque élève quel que soit leur niveau initial. Mais cela reste un lieu où l’on apprend l’esprit de compétition, quelque chose d’inhérent à la société qui empoisonne l’école. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’élèves qui ne réussissent pas à l’école que l’on doit les discriminer. C’est très difficile à vivre et à supporter pour eux, eux qui ont bien souvent des problèmes sociaux, familiaux ou de santé.
Pourquoi avoir fait un parallèle dans votre avant-propos avec l’histoire d’un camp de harkis jugés inaptes au travail ?
Il s’agit d’une histoire familiale lié à un arrière-grand-oncle que l’on me racontait quand j’étais gamin. J’ai alors découvert ce camp Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) où pendant les années 1960 était accueillis des harkis jugés incasables, irrécupérables, à cause de l’âge, d’une maladie ou de troubles physiques ou psychologiques. J’ai gardé ce souvenir enfoui et quand j’ai découvert la Segpa et la souffrance à l’école, la dévalorisation, la violence, j’ai très rapidement ressenti le parallèle entre mes élèves et cette histoire. Dans cet avant-propos, c’était une façon pour moi d’amorcer quelque chose, comme une réflexion pour créer du lien. A l’avenir, j’aimerais traiter l’histoire de ce camp dans le cadre d’un roman fiction. Pour le moment, je vais me concentrer sur l’écriture de mon deuxième livre chez Robert Laffont pour la rentrée littéraire 2022. Toujours sur la difficulté scolaire, avec cette volonté de porter des idées progressistes.
Comment êtes-vous devenu enseignant ?
Mon père était prof de sciences dans un lycée au Maroc. Après mon baccalauréat obtenu à Cavaillon dans le Vaucluse, je ne savais pas comme beaucoup de jeunes vers quoi m’orienter. Je savais que j’avais envie de travailler dans la fonction publique. J’ai d’abord fait des études pour devenir pompier puis j’ai réalisé un stage de quelques semaines à la fac qui m’a permis de découvrir l’enseignement en école primaire. J’ai beaucoup apprécié la dynamique et le métier. C’est comme ça que j’ai décidé de m’inscrire à l’Université d’Aix-Marseille et obtenir mon Master MEEF pour devenir enseignant.
Débarquer en France dans le Vaucluse, une terre d’extrême droite, n’a pas été trop dur ?
En vérité, avant le Vaucluse, mon premier choc a été mon passage de l’école marocaine à l’école française, au collège français de Fez. On a découvert dans ma famille que nous étions français par mon arrière-grand-père. On avait donc le droit du sang et c’est comme ça que mes parents ont décidé de m’inscrire à la mission française, un établissement qui date du protectorat. Ce n’était pas ma langue et d’un coup on parle français, on fait ses études en français. Mon second choc, c’est mon arrivée à 15 ans à Cavaillon dans le quartier du Docteur-Ayme. Mon père a décidé de s’y installer pour sa retraite. J’étais en classe de seconde. Sur place, le FN, je ne l’ai pas vu tout de suite. Je ne suis pas du tout politisé et j’avais ce luxe de ne pas comprendre. Il y avait du racisme ordinaire mais je ne pouvais pas poser une analyse sur ce que j’entendais ou voyais. Je me souviens être particulièrement seul. Personne ne s’intéressait à moi. Je subissais des moqueries et n’avait pas forcément d’amis. On me voyait comme le blédard. Puis j’ai appris à trouver ma place. J’ai habité Cavaillon pendant trois ans, le temps du lycée, puis je suis parti sur Marseille pour mes études. Mes parents habitent encore aujourd’hui à Cavaillon.
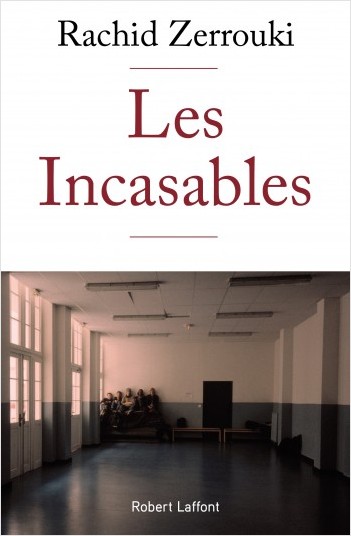
A 29 ans, vous vivez et travaillez à Marseille. Quel est votre regard sur cette ville cosmopolite aussi réputée pour son bouillonnement culturel que son désordre structurel ?
Marseille, c’est une ville qui accueille tout le monde. C’est très différent du Vaucluse où on retrouve encore cette recherche nostalgique de l’identité française, le fait de regretter la France d’avant. A l’inverse, Marseille a toujours été une ville historiquement accueillante. Cela se voit au quotidien. On ne regarde pas le temps où on était entre blancs de souche. La créolisation, on la voit énormément à Marseille. Il y a du mélange et ça me plaît, forcément. A Marseille, on ne se sent pas étranger. On se sent à sa place. Aujourd’hui, je peux dire que je me sens Marseillais. Je ne me vois pas quitter cette ville. J’y suis très attaché même s’il y a beaucoup à reconstruire. Face à la métropole qui a beaucoup de pouvoir, on sent que la nouvelle municipalité impulse de nouvelles choses. Il y a beaucoup à faire en termes de rénovation des bâtiments. Quand les immeubles de la rue d’Aubagne se sont effondrés, on a laissé croire que ça concernait que cet endroit de la ville. Or, il y a des tas d’immeubles sur le point de s’effondrer. Le problème perdure. On déplace des familles dans les quartiers Nord au lieu de les réinstaller en ville. Beaucoup d’écoles présentent aussi des problèmes d’infrastructures. Malgré cela, on a toujours l’espoir que ça aille mieux. Cela reste une ville où il fait bon vivre. Je traîne souvent dans le centre, vers le Cours Julien qui est très vivant.
Pour finir, quel message souhaitez-vous adresser à cette France qui n’ose toujours pas se regarder en face avec lucidité ?
J’ai envie qu’on mette de côté nos différences pour parler de ce qui nous unit. Car il y a des choses qui nous unissent. Nos conditions de travail, notre sécurité sociale, nos hôpitaux, nos écoles. Faire ensemble, créer un récit commun, c’est ça dont j’ai envie. Mettre en avant ce qui nous concerne tous et arrêter de cibler nos différences. Pour la prochaine élection, je ne me fais pas d’illusion. On va parler immigration, sécurité, mais pas comme il faut. Je suis assez dépité par les débats. On dirait le jeu où le gagnant est celui qui promet d’accueillir le moins d’étrangers, de noirs et d’arabes. J’ai fait une croix pour 2022 car on est à trop court terme mais je garde espoir pour la suite. Pour que ça aboutisse, il ne suffit pas d’ajouter des logos ensemble. Mais se baser sur un socle de valeurs communes.
Recueilli par Florian Dacheux
Photos : Joelle Fucito et Florian Dacheux
Illustrations : Twitter Rachid L’Instit
(Les Incasables, Rachid Zerrouki, Editions Robert Lafont)
Également au Livre de poche.